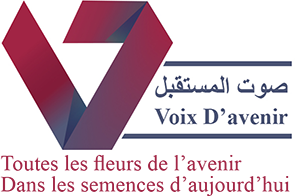En recevant mon recueil de poésie en langue française publié en 2023, Aimer les cinq sens de la main des étoiles, l’ami Marc Gontard, Professeur émérite de l’Université de Rennes II, Grand spécialiste de critique et pensée littéraires, mais aussi poète et romancier de grande qualité, a promis un article sur ce recueil dans lequel il soupçonnait un centre d’intérêt méritant une exploration interrogative et conversationnelle.
En juin 2025, partant pour un séjour estival à l’hôpital, il a pris ce recueil dans ses bagages et à peine a-t-il commencé son traitement que le voici m’envoyer, le 2 juillet 2025, cet article, « Pour Mansour » qui porte l’aimance au sommet de l’intelligence du sens, celle de son incomplétude.
Prompt rétablissement mon cher Marc, nous t’attendons pour un autre bout de voyage ! (Fidèlement tien, Mansour)

Pour Mansour
Éloge de l’incomplétude
On connaît, Mansour M’Henni, brillant chercheur et infatigable pourvoyeur d’idées, dont les études sur Kateb Yacine ou sur Le texte mixte dans la littérature tunisienne ont fait un acteur important de la critique maghrébine. On connaît mieux encore, aujourd’hui, Mansour M’Henni, réinventeur de Socrate et promoteur de la Nouvelle Brachylogie avec ses multiples applications en poétique, dans les arts, les sciences, les études comportementales, jusqu’au discours politique avec son intrusion dans le domaine de l’éthique conversationnelle. On connaît moins, peut-être, le poète, c’est-à-dire l’homme dans son humanité profonde dont j’avais préfacé l’un des tout premiers recueils dans les années 90. Une dizaine d’autres ont suivi depuis, jusqu’à ce dernier, au sens énigmatique : Aimer les cinq sens de la main des étoiles (2023) qui nous transporte, du cadre logique et argumentatif propre au discours universitaire vers les espaces libres de l’imaginaire et de la création.
Car, si l’on retrouve, dans ce recueil, certains thèmes qui apparaissent déjà dans Rosée (1992), Mots d’amour (1999), Là-bas (2006), La deuxième déjà… ou c’est toujours la première (2009), Résonances (2021), les choix formels qu’il adopte approchent au plus près l’expérience poétique, conçue comme écriture de l’émotion, pour poser la question de l’être-au- monde, entre le moi et le soi, l’autre et les autres, l’espace et le temps, avec une question essentielle, celle de l’incomplétude, dont la réponse reste au-delà de notre sphère cognitive.
Une écriture de l’émotion :
En effet, s’agissant du dispositif textuel utilisé pour ce recueil, Mansour a choisi d’investir son imaginaire dans une forme qui peut sembler académique – le vers syllabique – mais qui convient particulièrement à l’état émotionnel, qu’il veut nous faire partager.
Tout d’abord, étendu à l’ensemble des poèmes, le principe de la forme brève, dans son double effet de concision et de condensation, permet de retranscrire l’immédiateté et l’intensité du moment émotionnel générateur d’images.
A l’intérieur de ce cadre formel, l’utilisation d’une mesure métrique régie par la rime, dont la séquence de base reprend les modèles classiques de 6, 8 ou 12 syllabes, inscrit dans le texte une pulsion répétitive en lien avec un rythme plus fondamental qui renoue avec les racines physiologiques de l’état poétique.
Tout est là. Etre poète, c’est savoir exprimer dans la langue, ce moment fugace où l’affectivité prend les rênes du discours, sans que l’émotionnel puisse avoir un effet désastreux sur le rationnel comme on le croit trop souvent, alors que l’émotion, comme état affectif, peut acquérir, au même titre que la raison, une valeur cognitive. C’est ce que nous confirme l’expérience poétique de Mansour dont le paysage mental porte l’empreinte du sentiment d’incomplétude, chaque émotion particulière où s’engendre le poème, renforçant la tonalité d’ensemble du recueil.
C’est pourquoi, par bien des aspects, ce recueil tient de l’élégie, comme le suggère l’image récurrente de la fleur à la beauté éphémère dont Mansour ne craint pas de réinvestir la métaphore usée pour exprimer le sentiment d’incomplétude comme forme de mélancolie, c’est-à-dire de souffrance, face à l’impermanence, au sentiment d’usure, de détérioration, qui caractérise l’existence, mais qui en fonde aussi la valeur, en nous offrant la possibilité d’éprouver la plénitude de l’instant, tout comme l’éclosion d’une fleur reste un puissant appel à l’amour et à l’aimance. D’où le titre : « Aimer » qui pose d’emblée la question des rapports entre moi, les autres et le monde, au cœur de la tonalité mentale du recueil.
Qui suis-je ?
La poésie élégiaque étant par nature même l’expression de l’intime sans le truchement d’une quelconque instance énonciative, l’une des questions fondamentales qui obsède le poète est celle de la figure de soi, comme être souffrant, frappé par cette douleur secrète qui change l’écriture de « Ma lettre » en « mal être » (P.27) … Même sentiment qui transforme en mot-valise une insatisfaction existentielle (déçu) et la forme humaine du non-être (décès) en « Décèçu » (P.67). Il y a donc dans ce recueil l’expression d’une insatisfaction qui peut se commuer en « rage furibonde » et dont l’origine est le doute sur soi. Qui suis-je ?
Certes cette douleur peut naître de tout l’inaccompli que révèle une existence lorsqu’elle revient sur elle-même et qu’il ne lui reste que le « sevrage des soifs inassouvies » (P.44). Elle peut venir, d’une manière plus profonde, du doute sur le savoir qui pose la question du vrai :
Mais à la fin suis-je certain
De savoir vrai ce que je sais (P.56)
0r cette question porte en elle l’incertitude actuelle sur le problème de la réalité lorsque le savoir scientifique et universitaire est traversé non seulement par la croyance et le prosélytisme religieux, mais par toutes les formes de propagande des sociétés contemporaines qui mettent en cause la rationalité, la liberté et la démocratie : qu’il s’agisse des vérités alternatives des états orwelliens dont la seule parole autorisée est celle qui fonde leur dictature, ou de l’endoctrinement et la désinformation auxquels se livrent volontiers les partis politiques, jusqu’aux théories fumeuses des conspirationnistes, sans parler du bourrage de crâne quotidien de la publicité et autres boniments des influenceurs sur les réseaux sociaux… Le mal-être du poète, au-delà même des limitations du savoir humain, toujours, in progress, porte donc en lui, de manière implicite, ce débat autour de la post-vérité qui met en doute le réel, la science et les progrès de la connaissance. Et contre ce monde de bullshit dans lequel risquent de s’enliser les démocraties affaiblies, avant de devenir de simples « Dictacraties » (P.43), la parole du poète retrouve, par d’autres voies, le chemin du vrai, aux côtés de la science comme « conscience rebelle » (P.39)
Moi et les autres :
Ce doute sur soi explique le sentiment de solitude qui s’exprime dans certains poèmes lorsque l’autre s’efface comme présence nécessaire au moi : « Ma solitude est ma moitié » (P.46). En effet, si le « soi », c’est « moi » dans son rapport à l’« autre » (psychologie sociale), toute défaillance de l’autre, est vécue comme une atteinte à soi dans son désir d’ «aimance » qui fonde l’être humain dans son besoin de socialité. Car le « un » est « pluriel » (P.47) et l’affaissement de la pluralité dans la conscience de soi entraîne le sujet sur la pente d’une certaine déréliction :
La solitude
C’est le désir de soi
Où retrouver les autres (P. 18)
Deux grandes figures de l’altérité apparaissent dans la poésie de Mansour. D’abord, celle de l’ami auquel sont consacrés les deux premiers poèmes du recueil.
« Amitié » exprime un regret, celui de la présence dans l’entourage de soi de nombreux faux-amis, des « similis » … car l’amitié est un sentiment exigeant qui lie les partenaires dans une complicité à la fois totale et dialectique. Mais la fin du poème écarte cette réserve en proclamant la foi du poète dans ce sentiment rare qui enrichit le moi :
Cependant je le dis
Oui l’amitié sourit
Dans les cœurs de prestance
Dans l’esprit de l’aimance (P. 9)
Le second poème revient sur les mauvaises surprises que peut réserver un tel sentiment lorsqu’on se lie trop facilement à la recherche de l’alter-ego qui ne peut être un double, renvoyant, dans un effet miroir, le moi narcissique à lui-même. Il doit y avoir, au sein de l’amitié, à la fois le même et l’autre, d’où la complexité du sentiment et la confiance mutuelle sur laquelle il repose qui ne tolère aucune défaillance. C’est ce que recherche le poète en quête d’une authentique altérité fondée sur le partage et c’est ce par quoi il avoue être souvent déçu. L’amitié est plus qu’un sentiment, c’est une vertu…
L’autre grande figure de l’altérité est la figure féminine et l’on retrouve, chez Mansour, d’un recueil à l’autre, l’expression du désir et la quête de l’amante, élément fondamental de l’élégie. D’où la métaphore florale qui apparaît dès le 3ème poème du recueil « Ose » où, pastichant les vers célèbres de Ronsard, le poète supprime le R initial de la fleur pour mieux exprimer ce moment de défi et d’oubli absolu où nous plonge la tensivité même du désir.
Mais comme l’amitié, l’amour, dans la relation complexe qu’il ouvre avec l’autre, est un sentiment triplement exigeant qui mêle le cérébral, le sensuel et l’affectif… C’est pourquoi, la couleur même de la « Fleur d’anniversaire » (P.17) reste un leurre dans la mesure où le charme de l’amante est à la fois essentiel et indéfinissable. En ce sens, l’amante n’a pas de figure ou, plutôt, elle a toutes les figures qui coagulent en désir le sentiment d’être dans le partage des corps et l’illumination du plaisir commun (« Mon amie la fleur », P. 61).
Si la quête amoureuse est celle d’une fusion extatique avec l’autre, c’est aussi une quête sans fin, vouée à l’échec par son caractère absolu qui ne supporte ni l’habitude, ni le quotidien. D’où l’ambivalence du sentiment :
Toujours une histoire de seuils L’amour
Seuils à franchir et seuils infranchissables (P.12)
Le jeu de mots entre « franchir » et « affranchir » à la fin du poème, réinstalle la notion de défi, au cœur de l’expérience amoureuse. La rencontre de l’amante, qui conduit à l’exultation du moi, suppose une levée de bien des barrières et autres interdits, qu’ils soient d’ordre social ou internes au sujet qui vit l’amour comme une libération, un moment fort d’exaltation de l’être dans le déport de soi vers l’autre. Mais un moment fragile car l’état passionnel ne peut qu’être transitoire, ne laissant plus tard que le souvenir fané de « L’ivresse qui délivre » (P.23).
Ainsi, à partir de deux sentiments privilégiés, l’amitié et l’amour, le poète, dans sa rencontre avec l’autre, éprouve-t-il une forme d’insatisfaction qui peut mettre le moi en péril et le rejeter dans la solitude, car l’exigence d’amitié suppose un effort vertueux peu commun. Quant à la rencontre amoureuse, au-delà du défi qui mène à l’effusion des corps, il y a dans l’amour un absolu qui le met souvent hors de portée ou qui en fait l’une des grandes figures du tragique (Tristan et Yseult ; Majnoun Leila) …
L’élégie du temps qui passe :
Si l’acmé, dans la passion amoureuse, tire son intensité de sa propre éphémérité, le sentiment du temps qui passe constitue l’essence même de l’élégie. C’est en effet le temps qui est l’acteur principal de la dégradation inéluctable de l’être. Comme il flétrit la rose ou le coquelicot, il emporte le moment de nos joies les plus vives dans son flux destructeur, ne laissant subsister en nous que le souvenir, pâle reflet d’une réalité dissoute :
Le moment de sentir
L’effet d’un temps pesant
Comme un fumeux présent
Toujours prêt à partir (P.70)
Dès lors, la seule réalité offerte à l’homme est celle de l’instant, face au rêve d’éternité qui l’étreint. D’où ce dialogue avec la mer, vieille allégorie de l’infini dans son impensable, face au désir d’immortalité :
J’interroge l’instant
Sur l’essence durable
Et la mer me répond
Le silence ineffable (P.32)
En fait, le temps qui détermine la durée humaine n’est que l’agent de la seule certitude qui nous soit offerte, celle de la mort, qui concentre toutes les questions sur l’être et le non-être. C’est pourquoi ce recueil qui s’ouvre comme une méditation sur l’être-au-monde, s’achève sur la perspective de la mort qui occupe les derniers poèmes. Voyant tous ses amis qui « partent en série » et saluant le retour du printemps, saison de sa venue au monde, comme l’annonce de son prochain départ, le poète s’interroge face à « L’abîme », avec des accents baudelairiens, sur le « néant », comme terme ultime de notre passage ici-bas (P. 72). Mais face à cette interrogation qui pose le vrai problème de la mort comme dissipation de l’être, Mansour ne tranche pas, optant pour la vieille allégorie du voyage dont on ne connaît pas le terme. Laissons plutôt la rivière nous emporter sur une planche, « vers quelque part » (P.74) … Si l’ombre de la mort qui borne notre horizon, comme ces « nuages noirs » qui se lèvent parfois sur la mer, reste la cause la plus profonde de l’incomplétude de notre condition, le trépas, chez Mansour, loin d’être considéré comme un terme tragique, garde son mystère ouvert à tous les possibles :
La mort reste la mort
Juste une entrée au port
Après un court voyage (P.77)
Toujours la mer :
On pourrait croire que dans une poésie de l’intime comme celle de Mansour, le paysage, au sens géographique du terme, a disparu. Il n’en est rien. Sauf que le monde extérieur, en dehors de la fleur et de quelques reliefs urbains, n’est représenté que par un seul élément, la mer, qui baigne le petit port natal de Sayada. Et il ne s’agit pas seulement d’une simple allégorie, mais bien plus, d’une présence forte et quotidienne qui relie le sujet au paysage d’enfance, profondément inscrit dans son onirisme. Car nous portons tous en nous un paysage intérieur qui nous relie à nos lieux de prédilection. Mansour est habité par la mer qu’il contemple toujours du littoral où s’achève le monde des terriens et où s’ouvre l’immensité marine qui donne aux habitants de la côte ce sentiment océanique qui est comme un parfum d’éternité. Et lorsque le poète envisage la ville, entre le « fort » et l’« aéroport » qui désignent à la fois le passé et le futur, face au doute qui s’élève en lui, c’est la mer qui lui offre son apaisement :
Immobile et perdu au milieu de la route
Un humain semble pris dans les rets de cent doutes
Et se dit qu’à la fin tout est beau dans la mer (P.28)
D’une manière plus générale, la mer chez Mansour, oppose sa lumière aux noirceurs du soir et de la ville (P.41). Le plus souvent, elle est rêvée comme calme et accueillante, ultime recours aux doutes et aux tracas de l’existence. Dans le paysage mental, la mer par sa seule présence est porteuse d’équilibre et de sérénité, image de la plénitude qui vient guérir l’incomplétude. Contre l’espace urbain aux images généralement dysphoriques, car entachées par la précarité du lien social, elle devient médiatrice de son adhésion au monde :
Pourquoi chercher ailleurs
Quand la mer généreuse
Te berce de douceur (P.60)
Pour conclure : être
En effet, si la poésie de Mansour porte en elle le sentiment mélancolique d’une forme d’incomplétude qui affecte le moi, s’étend à ses rapports à l’autre et se renforce de l’énigme du temps destructeur, de sorte que la « Déception » reste indissociable de toute expérience humaine (P.48), cette fragilité du sujet n’empêche pas son consentement à l’être que la mer vient magnifier, y compris dans son acceptation de la mort à laquelle l’inconnu donne son prix. D’où cette ultime interrogation : la mort comme « pas vers l’abîme » ou fin d’un « chant sublime » ? (P.71)
Au-delà d’une écriture de l’émotion, la poésie de Mansour, tout en marquant les points d’incomplétude de notre être-au-monde, reste une leçon d’humanisme qui n’entend pas apporter une quelconque solution aux béances du réel, mais simplement montrer comment nous avons un devoir, non pas de résilience, mais d’adhésion à ce qui fait notre humanité dans ses joies comme dans ses imperfections :
Je n’ai jamais assez
Des délices du monde
Et c’est sans grand regret
Qu’un jour j’en partirai
Heureux d’avoir été (P.20)
Être, dans la conscience de soi, en développer toutes les virtualités, jusqu’à l’acceptation du non-être, voilà ce qui fait la grandeur de l’homme dans le sujet à construire soi-même, entre sa propre ipséité et l’ouverture à l’autre et au monde. C’est la grande leçon d’un recueil comme Aimer les cinq sens de la main des étoiles, qui en éclaire peut-être le titre :
Etre du monde entier
Tout en étant soi-même
Et de l’éternité
Un bref instant
Suprême (P. 19)
Marc Gontard
Juin-juillet 2025